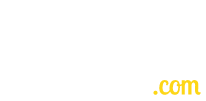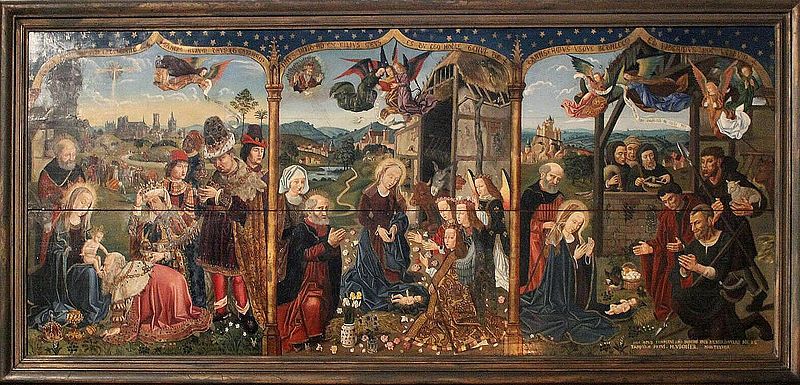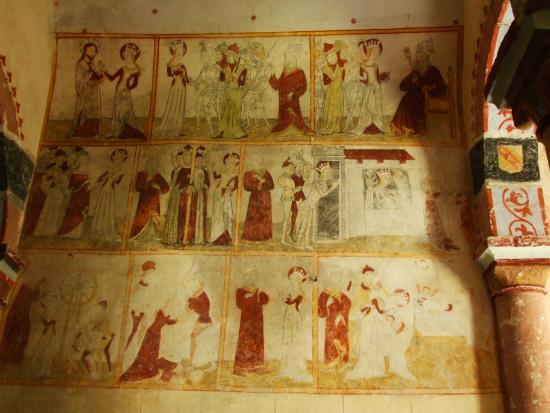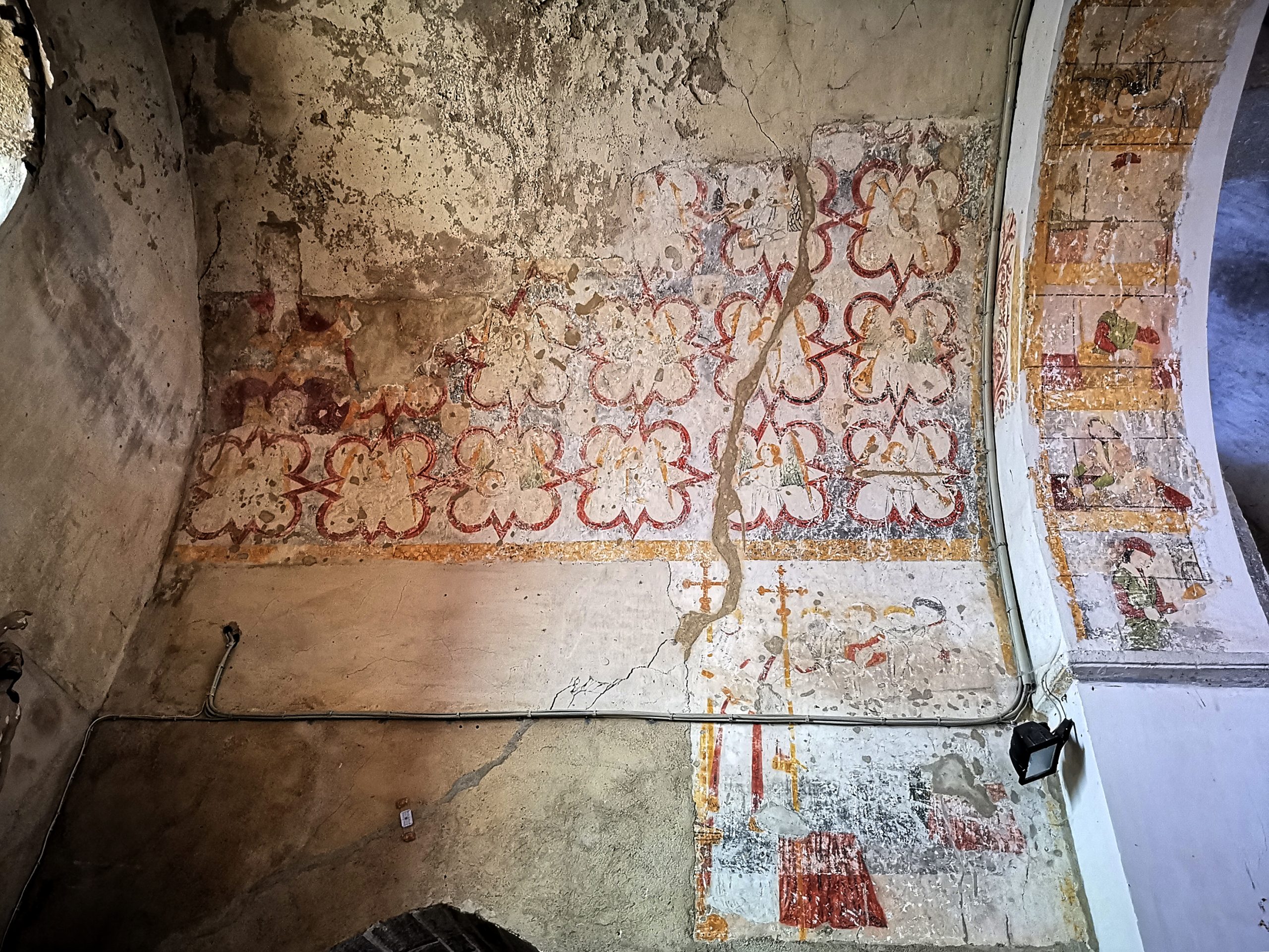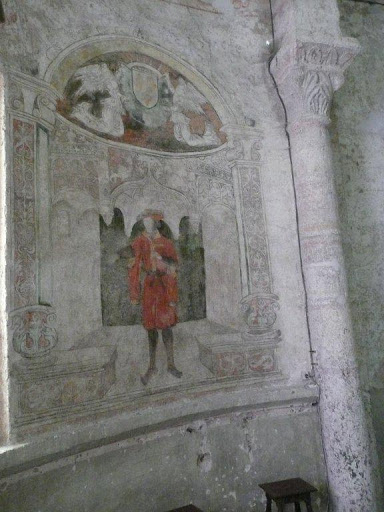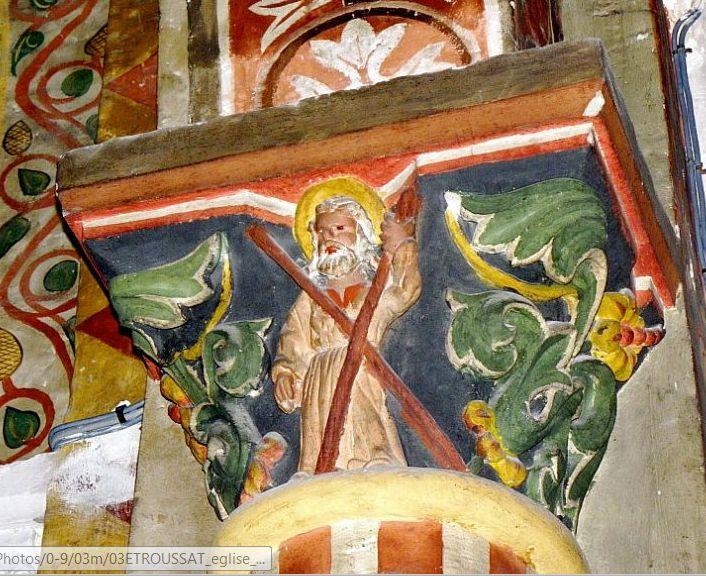Epoque : fin XIX°- Protection : classé MH (1987)
Propriétaire : commune
Visite :
Dates et horaires : L’église est ouverte toute l’année de 9h à 18 (17 h en hiver) de 9h30 à 12h le dimanche
Elle est fermée les lundi matin et les dimanche après-midi.
Visite libre avec document
Adresse :10, Place Jean Dormoy 03100 – Montluçon
Téléphone : 04 70 05 11 44
Courriel :
Site internet :




Situation
10, Place Jean Dormoy 03100 – Montluçon
Histoire
L’église Saint-Paul est l’une des seules églises de France construite avec une structure de fer et de fonte, par le grand architecte Louis Auguste Boileau, en 1867). L’architecture métallique a été entièrement réalisée par l’usine des Hauts-Fourneaux de la Société de Commentry-Fourchambault.
L’édifice est construit en pierre de Bourré et en pierre de Volvic, il fait actuellement l’objet des dernières restaurations afin de lui rendre son lustre originel. En dehors de l’ornementation du portail qui utilise la pierre de Volvic, les murs sont faits de matériaux légers, comme la pierre calcaire de Bourré, du Loir-et-Cher. Un choix économique qui a très rapidement fragilisé l’édifice : restaurée une première fois en 1896, à cause de la pollution liée à l’industrialisation, l’église est débarrassée de sa balustrade et de ses clochetons d’ornement, avant de faire l’objet en 1936 de réparations qui finissent de lui faire perdre son style. En quelques décennies seulement, l’église Saint-Paul a complètement changé d’apparence et perdu progressivement de sa superbe, sans pour autant se préserver de l’usure du temps.
L’édifice a été classé au titre des monuments historiques le 15 septembre 1987.
Construction
L’église fut construite de 1863 à 1869 par l’architecte Louis Auguste Boileau, dans un quartier neuf où venaient de s’installer les hauts-fourneaux de l’usine Saint-Jacques. L’édifice bénéficia, dans sa construction, des nouvelles techniques offertes par le métal (piliers en fonte). Edifice de plan basilical avec un clocher porche, quatre travées, une nef principale flanquée de bas-côtés, une travée de chœur et une abside à pan coupé entourée d’un faux déambulatoire également à pans coupés, constituant la sacristie.
Le système de voûtement de nervures d’ogives comporte, au lieu des clés habituelles, un puits de lumière carré vitré percé dans la toiture. La façade occidentale est dominée par le clocher, édifié sur un massif rectangulaire avec un porche central flanqué de deux chapelles latérales, éclairées chacune par une baie en arc brisé.
Le portail néo-gothique s’ouvre sous un arc brisé appareillé avec des pierres de deux couleurs alternées (Volvic gris et calcaire blanc). Les vitraux historiés du chœur et de l’abside semblent appartenir aux années 1870-1880.
(source : auvergne-centrefrance.com)
Les environs
Montluçon – le Musée Mupop à 1.1 km au sud-est
Montluçon – église Notre Dame à 1.1 km au sud-est
Montluçon – château de La Louvière à 2.1 km à l’est