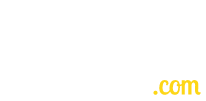Epoque : XII°- Protection : MH
Propriétaire : commune de Rocles
Visite : oui
Dates et horaires :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Site internet :
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.



Situation
Rocles est situé à 32 km au sud-ouest de Moulins
Histoire
A la fin du IIIème siècle, d’après M.Bougerolle instituteur à Rocles, Saint-Saturnin (ou Saint-Sornin) introduisit la religion chrétienne dans cette région. La commune voisine porte d’ailleurs son nom (Saint-Sornin) et l’église de Rocles lui est consacrée (sous son autre nom : Saint-Saturnin). Ce saint venait de Toulouse où l’on retrouve l’église Saint-Sernin. Deux autres prêcheurs avaient également sillonné la contrée. II s’agissait de Saint-Ourse ou Saint-Ursin, venu de Bourges et Saint -Austremoine arrivé de Clermont.
C’est vers 1150 que fut construite l’église ; mais de ce premier édifice de style roman, il ne subsiste que l’abside en hémicycle (flanquée au Nord d’une très petite absidiole de même tracé), et le mur de façade. Ces deux parties sont réunies par une nef entièrement reconstruite au XVème siècle, en style gothique, et qui comporte quatre travées.
La paroisse de Rocles appartenait autrefois au diocèse de Bourges. L’église Saint-Saturnin dépendait alors du monastère du Montet. C’est un monument de style gothique, à l’exception du chœur, de l’absidiole nord et du portail ouest. Elle comporte une nef principale de 3 travées, flanquée au sud d’un bas-côté de 4 travées.
Les éléments les plus remarquables de l’architecture sont le clocher, assis sur la travée droite de l’abside, avec une base romane quadrangulaire surmontée d’une flèche gothique en pierre de plan octogonal, et surtout le portail ouest : de style roman bourguignon, il est entouré d’une archivolte en plein cintre aux voussures garnies de damiers, d’oves de palmettes et de billettes, et que reçoivent de chaque coté, trois colonnettes en délit à chapiteaux d’entrelacs.
Le tympan, supporté par deux colonnettes appareillées dressées contre les piédroits, est découpé en festons.
A l’intérieur, l’absidiole nord conserve la statue sur bois de la Vierge. Assise comme les vierges à l’enfant de l’époque romane, elle appartient pourtant au style et à l’époque gothique.
Elle fut trouvée par “hasard” entre les deux guerres dans les combles de l’église où elle avait été cachée pendant la révolution. Haute de 78cm, elle tient dans sa main droite un fleuron. C’est une statue de transition.
On trouve aussi un grand bénitier de pierre, en forme de chapiteau (seconde moitié du XIIème siècle) décoré de rinceaux végétaux.
(source”rocles03.free“)
Les environs
Le Montet – Eglise Saint-Gervais – Saint Protais à 3.4 km au sud-est
Noyant d’allier – Les Côtes Matras à7.4 km au nord-est
Buxières les Mines – Château de La Condemine à 9.2 km au nord-ouest