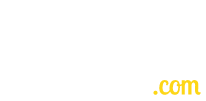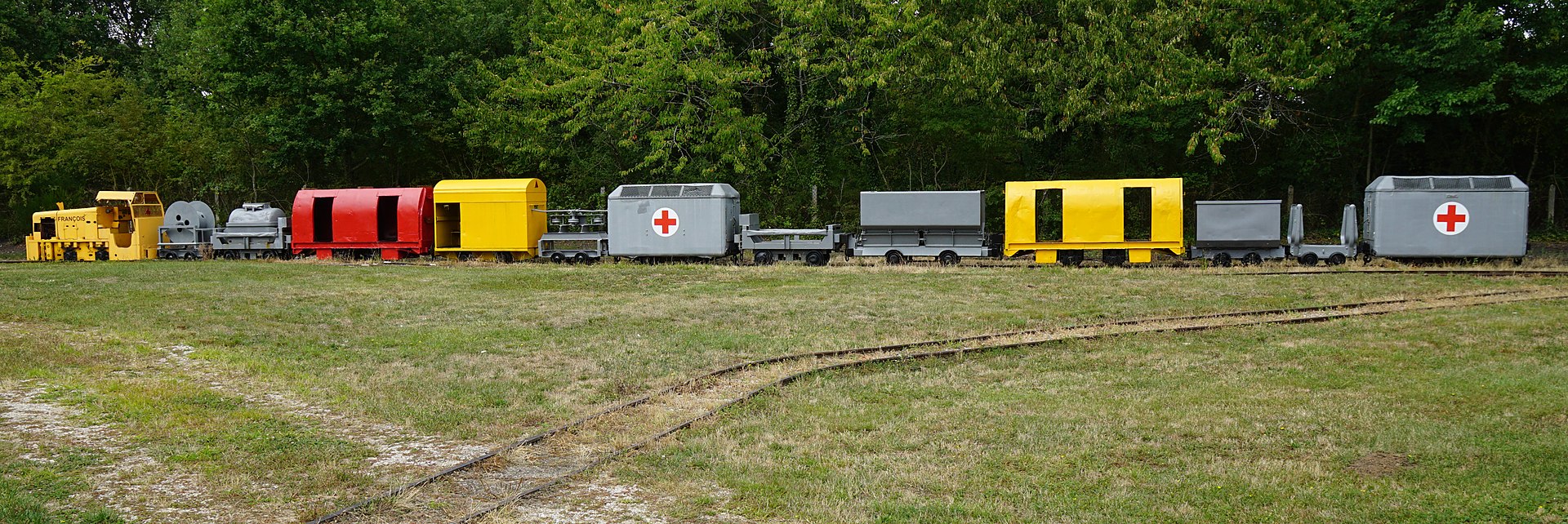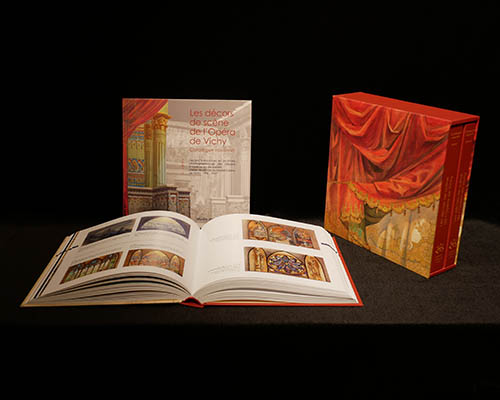Epoque : – Protection :
Propriétaire :
Visite : oui
Dates et horaires : du 1er avril au 1er novembre
Avril • Mai • Juin • Septembre • Octobre
ouvert du mardi au dimanche après-midi de 14 h 00 à 18 h 00 ainsi que les jours fériés
Juillet • Août • vacances de Pâques et de Toussaint
ouvert du mardi au dimanche de 10 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00
Adresse : Magnette – 03190 Audes
Téléphone :04 70 06 63 72
Courriel :
Site internet : canal de Berry
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

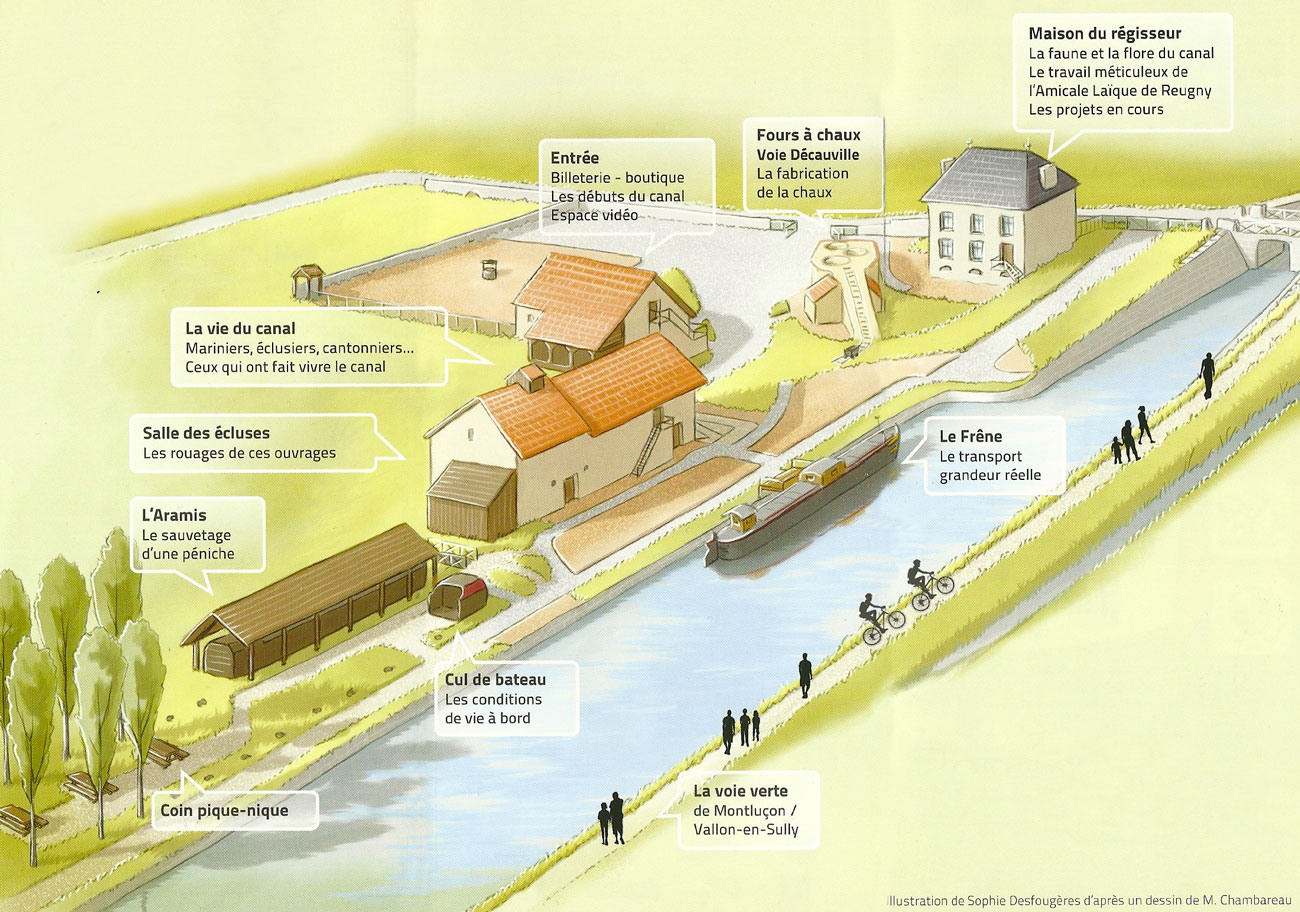

Situation
Audes se situe à 16,6 km au nord de Montluçon
Le musée du canal de Berry se situe à Magnette à 3,8 km à l’est d’Audes
Histoire
Situé au bord du Canal de Berry en plein cœur du Val de Cher, le musée fut créé en 1978 sur le site d’anciens fours à chaux par l’amicale laïque de Reugny. Chaque année, cette association de bénévoles créait une exposition sur un thème local et elle ne savait pas que l’exposition consacrée au canal de Berry allait être le début d’une grande aventure.
René CHAMBAREAU et quelques bénévoles ont réuni quelques pièces récupérée ici ou là, des dons de mariniers, d’éclusiers, de cantonniers, des dizaines de recherches, de rencontres et ont permis trente ans plus tard de constituer une collection unique sur le Canal de Berry. Ce fond est composé de près de 4000 pièces regroupant des documents administratifs, des plans d’époques, des objets de mariniers mais aussi des pièces monumentales comme des portes d’écluses et deux authentiques péniches ayant naviguées sir le Canal de Berry sauvées d’une destruction certaine.
Le canal, aujourd’hui, offre un nouvel engouement par la création d’une voie verte pour les amoureux des balades calmes sans moteur et pour les sportifs.
Les environs
Audes – Le château de la Crête à 3,2 km à l’ouest
Reugny – le prieuré Notre Dame à 1,1 km à l’est
Saint- Désiré – église Saint-Désiré à 16,6 km au nord-ouest